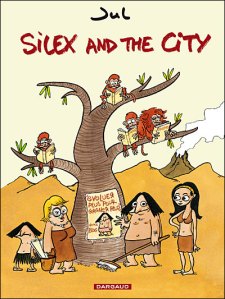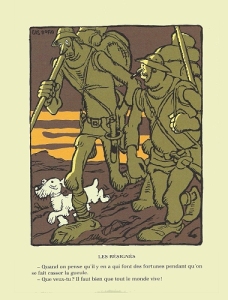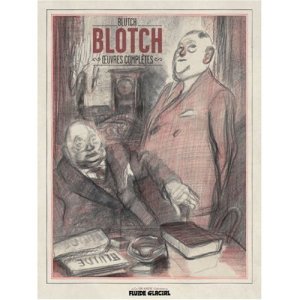Rejouissez-vous (ou pas), je reviens à la charge avec mes articles sur les blogs bd !
Pour lire l’intro : intro
Pour lire la première partie : définir un blog bd
Pour lire la deuxième partie : petite histoire des blogs bd français
Pour lire la troisième partie : blogs bd face à l’édition papier
Lorsque l’on considère un contenu Internet, quel qu’il soit, il ne faut pas oublier la dimension communautaire. C’est là une des caractéristiques principales du média Internet tel qu’il s’est développé, en particulier dans sa version 2.0 (notion théorisée par Tim O’Reilly, dont vous pouvez avoir une définition ici : http://fr.wikipedia.org/wiki/Web_2.0 ) : l’usage qui en a été fait est celui d’un espace d’échange auquel n’importe quel utilisateur peut se connecter ; échange d’idées, d’informations, de contenu, de marchandises… Il y a, à tort ou à raison, une utopie Internet qui voudrait que ce média rende possible des rencontres qui n’aurait jamais eu lieu sans lui. Voilà ce qui m’intéresse ici : la notion de « rencontre ». Le mouvement des blogs bd est indissociable de l’idée d’une reconnaissance commune. On parle de blogs bd parce que plusieurs utilisateurs, d’abord individualisés, se sont trouvés des similitudes dans l’usage fait d’un format, le blog. Puis, ils ont développés d’eux-mêmes une sociabilité propre autour de ce point commun (tenir un blog graphique), sociabilité utilisant généralement les ressources de leur média de référence, Internet, mais pas seulement. Le concept de sociabilité culturelle veut donc qu’un phénomène culturel n’existe et se développe que si ses acteurs s’identifient comme communauté, soit d’eux-mêmes, soit poussés par des facteurs externes. Selon ce processus apparaissent les grands mouvements culturels, la sociabilité ainsi formée étant, parfois (pas toujours) facteur de stimulation et d’innovation. Il est donc nécessaire, pour qu’un objet culturel puisse être identifié, qu’il y ait un espace « médiateur » qui en rassemble les acteurs et leur permettent de discuter ensemble. Avant que n’émergent les grands médias de masse aux XIXe et XXe siècle, ces espaces médiateurs étaient les cours des princes, les salons, les académies, les universités. Puis d’autres structures ont pris le relais : journaux, maisons d’édition, radio et télévision (je n’ai pas dit que cette stimulation culturelle aboutissait toujours à un résultat intellectuellement satisfaisant !) et enfin Internet à la fin du siècle dernier. Si on en reste au secteur de la BD, à d’autres époques, d’autres structures ont joué le même rôle que la blogosphère bd. Dans les années 1960, autour du journal Pilote dirigé par René Goscinny se sont rassemblés des personnalités qui ont permis la diversification et le déploiement de la BD adulte (Gotlib, Mandryka, Brétécher, Fred…). Dans les années 1990, autour de la maison d’édition L’Association se sont rassemblés des auteurs proclamant la Bd comme un art exigeant et poussant les limites du genre par les expérimentations de l’OuBaPo. La même chose se produit avec les blogs bd.
La différence essentielle est peut-être que, alors que dans les cas précédemment cités le lecteur n’avait accès qu’au résultat de cette collaboration et stimulation, Internet permet de rendre plus facilement visibles les processus communautaire pour l’internaute. Ou plutôt lui donner l’impression d’avoir accès aux structures de la communauté des blogueurs ; la blogosphère se transforme alors en un théâtre où chaque blogueur contrôle son avatar pour jouer le rôle qu’il s’est (ou qu’on lui a) assigné. Internet rend à la fois plus visibles et moins visibles les structures communautaires.
L’occasion pour moi de pointer et déchiffrer les espaces et procédés qui caractérisent la sociabilité culturelle des blogueurs bd.
Une sociabilité virtuelle, des moyens virtuels
En 2005 les flux RSS n’étaient pas encore extrêmement répandus et le meilleur moyen que les blogueurs ont trouvé pour se constituer en communauté est l’usage du lien, élément structurel de base de la navigation internet. Les blogueurs mettent donc en lien leurs collègues, ce qui facilite grandement la tâche de l’internaute qui peut ainsi, après avoir lu un blog, approfondir sa connaissance de la blogosphère (qui a dit « perdre encore plusieurs heures devant son ordinateur » ?). Le lien est le premier signe qu’une communauté se forme, même si au début ces liens traduisent des amitiés hors d’internet : Mélaka met en lien Cha et Laurel avec qui elle travaille. Certains blogs deviennent, en raison de leur audience, des blogs « d’autorité », comme celui de Boulet. (voir cette note de Ced où il explique sa tentative d’entrer dans les liens de Boulet : http://ceduniverse.blogspot.com/2006/01/voir-angouleme-et-mourir.html ).
Une étape nouvelle est franchie en matière de liens avec la création en 2006 de blogsbd.fr par Matt (http://blogsbd.fr/ ). Ce site se donne pour but de recenser un grand nombre de blogs bd, de signaler chaque mise à jour et de proposer à l’internaute une vision, certes subjective de la blogosphère mais néanmoins très complète. « Hub » de la blogosphère, le projet fonctionne, que ce soit pour les internautes qui s’en servent pour naviguer dans la blogosphère et pour les blogueurs qui y gagne une visibilité inédite. Ce qu’exprime manu xyz sur cette note d’avril 2009, à son entrée dans la base de Matt : http://manu-xyz.blogspot.com/2009/04/ho-putain.html . Beaucoup de blogueurs sont donc, à juste titre, reconnaissant à Matt de les avoir sélectionné et conservé dans la sélection dite « officielle », qui regroupe seulement une centaine de blogs et s’affiche comme page d’accueil du site. A l’inverse, être supprimé de la sélection officielle est bien souvent vécu comme un affront, le site étant vu par beaucoup comme une manne de lecteurs (comme récemment, Laurel dans cette note, http://www.bloglaurel.com/coeur/index.php/2009/10/13/2473-le-coup-de-free-n-est-plus-d-actualite-dans-cette-note, moins récemment Maadiar, http://maadiar.blogspot.com/2009/08/blogsbd-fait-chier.html ). Régulièrement ressort le débat de la fidélité du lectorat, de l’impact réel du site de Matt sur les statistiques d’audience, de la dépendance des blogueurs à blogsbd.fr (beaucoup d’internet utilisent aussi les flux RSS ou ne vont jamais sur blogsbd.fr), de la subjectivité de Matt. Ce dernier n’a jamais prétendu que son site était exhaustif et objectif, d’où une certaine ambiguité à le considérer comme une référence de la blogosphère. Blogsbd.fr n’est pas le seul portail de ce type, d’autres existent, (http://www.wikio.fr/blogs/top/bd, http://annuaireblogbd.com/ ) mais ne sont pas parvenus à s’imposer réellement face à la maniabilité de celui de Matt.
Il est naturel que les blogueurs bd utilisent les ressources directes de leur média. Si le lien est le meilleur manifestation de cet usage, d’autres espaces communautaires sont crées et investis, facebook, twitter ; mais surtout le forum La Brouette est spécialement conçu pour rassembler les blogueurs en une communauté. ( http://labrouette.org/index.php ) Les posts consacrés aux méthodes de dessin et de numérisation, ou encore à l’annonce de manifestation et aux galeries personnelles participent tout autant à l’identité du blogueur bd.
La passion commune du dessin
En dehors des ressources traditionnelles d’Internet, les blogueurs bd se sont crées d’autres moyens de rassemblement autour de leur passion commune, le dessin. La blogosphère se transforme alors en un espace de création en commun (création entendue au sens large).
Certains de ces projets communs sont de l’ordre du jeu graphique, rappelant ainsi la composante expérimentale des membres de l’OuBaPo qui, depuis les années 1990, tente d’appliquer les règles de l’OuLiPo à la création graphique. La BD, soumise à des contraintes, est alors vécu comme un moyen d’expression malléable et amusant. Dans le cas des blogueurs, la contrainte vient des caractéristiques structurelles du blog. Je citerai ici les plus marquantes de ces expérimentations qui, parfois, donnent lieu à d’intéressants dessins. Ainsi, le squat consiste en une « invasion » d’un blog en l’absence de son propriétaire par d’autres blogueurs qui dessinent tour à tour une note ; le ping-pong se fait entre deux blogueurs qui se renvoient l’un l’autre un dessin ou encore répondent en image à une suite de question posées par l’autre ; enfin, les chaînes sont un grand classique de la blogosphère : un blogueur transmet un questionnaire ou un défi à un autre blogueur qui doit y répondre et le transmettre à son tour. La « chaîne des blogbédéistes » concrétise ce dernier type de jeu en servant au passage d’annuaire (http://lachainedesblogs.canalblog.com/).
On peut opposer ces expériences ponctuelles à des projets plus ambitieux. Le site 30joursdebd, http://30joursdebd.com/, se donne pour objectif de publier une planche de bd par jour d’un dessinateur amateur. Il constitue un lieu d’échanges pour quelques blogueurs (Ced, manu xyz, Waltch, Ol Tichit, etc.). Les 24h de la BD est un projet lancé par Lewis Trondheim lors du festival d’Angoulême 2007, inspiré par un projet initial de Scott McCloud. Il se reproduit désormais régulièrement à chaque festival et a donné lieu à d’autres initiatives identiques. Sur un thème ou une contrainte donnée, des dessinateurs, amateurs ou professionnels, à Angoulême ou chez eux, doivent réaliser 24 planches de BD en 24h. Les résultats sont présentés sur le site http://www.24hdelabandedessinee.com/public/index.php. Les blogueurs sont également friands de cet événement dépourvu d’enjeu. Si la première édition n’a compté que 26 participants et a été édité sous format papier (Boule de neige, chez Delcourt), les suivantes ont accueilli près de 200 puis 400 participants. Le forum CaféSalé (http://www.cfsl.net/ ), quant à lui, regroupe principalement des illustrateurs en une « communauté créative », dont quelques blogueurs.
Enfin, une dernière exploitation très intéressante des possibilités communautaires de la blogosphère est le blog collectif, qui permet à deux ou plusieurs blogueurs de travailler ensemble via internet. Le plus célèbre est bien sûr le blog des Chicou-chicou, (http://www.chicou-chicou.com/ )faux blog dessiné depuis 2006 par Boulet, Domitille Collardey, Lisa Mandel, Aude Picault et Erwann Surcouf, récemment publié chez Delcourt. Chaque auteur garde son style et poursuit les histoires commencées par les autres. Le collectif Damned (http://www.blogdamned.com/ ) rassemble également quatre blogueurs, Clotka, Flan, Goupil acnéique et Olgasme, sur un site commun. Quelques blogs à quatre mains fleurissent également, comme Bruts (http://www.bruts.fr/ ) de Raphaël B et l’Esbroufe et le Loveblog (http://love-blog.fr/ ), de Gally et Obion. Dans les cas de Chicou-Chicou et de Bruts, le blog collectif est aussi l’occasion de sortir de l’aspect « carnet intime » du blog avec un projet plus construit et régulier, proche du webcomic.
Le blogueur bd « In Real Life » : sociabilité hors de la toile et rapport au public
Evidemment, les blogueurs ne sont pas que des êtres numériques : ils ont, comme nous, un coeur, un foie, deux reins. Ils possèdent donc une sociabilité hors de leur blog, qui leur permet parfois de rencontrer leurs lecteurs. Certaines notes font parfois écho de cette sociabilité : un classique des notes de blog est le compte-rendu de festival dans lequel le blogueur révèle ses rencontres, ses amitiés, ses coups de coeur. Je pense également aux nombreuses notes chez Mady, manu xyz, Bambii et Romain Ronzeau dans lesquelles ils mettent en scène leurs rendez-vous (http://www.destrucs.net/article-33609552.html ). Le blog devient alors un véritable théâtre, puisque chaque blogueur représente l’autre selon son avatar, laissant le lecteur dans l’expectative quant à la véracité de la scène. L’idée de communauté virtuelle, caractéristique de la toile, est encore amplifiée dans le cas des blogs bd par l’ambiguité entre l’apparente mise à nu des blogueurs qui font mine de se livrer tout en se masquant derrière un avatar dessiné. Les rapports vie publique/vie privée s’en retrouvent bouleversés et, par là, le blog donne aux lecteurs l’impression d’être proche du blogueur, croyant connaître les moindres détails de sa vie, alors qu’ils ne l’ont jamais rencontré. De la même manière, les blogueurs feignent une sociabilité, parfois vraie, parfois rêvée, cachant plus qu’ils ne révèlent. L’utilisation de l’avatar est la manière que l’auteur a de mettre un intermédiaire entre lui-même et son lectorat.
Le lecteur est d’abord vécu à travers les commentaires. Certains blogueurs, comme Lewis Trondheim et Manu Larcenet ne laissent pas à leurs lecteurs la possibilité de commenter (Larcenet en a d’ailleurs fait un album, Critixman, dans lequel il analyse et se venge des critiques venu du web). Toutefois, la plupart des blogueurs joue le jeu des commentaires. L’exercice est étrange, comme un dialogue souvent biaisé par l’apparent anonymat des commentateurs. Certains soutiennent, encouragent, donnent un avis constructif, tandis que d’autres inondent d’insultes ou partent dans d’interminables débats. Souvent arrive la réponse du blogueur ou de ses défenseurs : « si tu n’aimes pas ce blog, ne vient pas le lire », qui illustre très bien les limites de l’idéal communautaire du web, qui, bien souvent, ne fait que rapprocher des personnes qui se seraient naturellement rapprochés dans la vraie vie. Le blogueur essaye parfois d’accentuer la proximité avec son lectorat, beaucoup plus fort que chez n’importe quel dessinateur de BD non-blogueur, par une « radio-blog » à écouter, ou une boutique. Quant aux IRL, elles font partie du vocabulaire des internautes pour désigner des rencontres « in real life », et elles sont à l’occasion organisées par certains groupes de blogueurs à la fois pour se retrouver et pour rencontrer leur lectorat.
Le festiblog (http://www.festival-blogs-bd.com/ ) a été crée en 2005 par Yannick Lejeune (http://www.yannicklejeune.com/) comme la manifestation permettant de rassembler toute la communauté formée par le phénomène des blogs bd : dessinateurs et lecteurs réunis autour de séances de dédicaces gratuites. Chaque année, deux parrains sont désignés, qui dessinent l’affiche (Boulet et Mélaka furent les premiers) et tous les ans, le succès du festiblog est réel à la fois auprès des auteurs invités qui se déplacent de toute la France, et auprès des internautes. Le « fesse ton blog » est la forme alternative de ce festival, lancée en 2008 par Slo et Louna, avec comme objectif aoué une absence totale d’organisation (http://fesstonblog.blogspot.com/ ). La mise en place très rapide du festiblog, dès 2005, a sans aucun doute contribué à façonner la blogosphère, à mieux l’identifier et lui donner une visibilité médiatique, puisque l’évènement, qui se déroule à Paris (d’abord à Bercy Village puis à la mairie du IIIe depuis 2009), est évoqué par les médias. D’une quarantaine d’auteurs invités au départ, les organisateurs ont pris acte de l’expansion du phénomène et la dernière édition en accueillait 112, sans compter les nombreux dessinateurs non-invités mais malgré tout sur place pour dédicacer. Les organisateurs citent 3000 visiteurs dès l’édition 2005, autour de 6000 pour les suivantes. Si certains blogueurs bd sont également présents lors des festivals de BD traditionnels, le festiblog est devenu un passage obligé qui donne littéralement corps à cette nouvelle communauté culturelle née sur le net. Internet est d’ailleurs le seul point commun de tous ces auteurs aux parcours, aux âges, aux styles, aux motivations et aux personnalités extrêmement variés, au-delà de toute notion d’école ou de courant. D’où le terme de « communauté » qui me semble le mieux convenir pour définir ce groupe culturel.
Et le festiblog est évidemment l’occasion, pour les blogueurs, d’une nouvelle note de blog, la boucle étant ainsi bouclée. Je vous laisse avec un dessin de manu xyz, qui conclut très bien le dynamisme de la communauté des blogueurs bd : http://manu-xyz.blogspot.com/2009/09/la-bande-des-4.html.
A suivre dans : le Bien, le Mal et les blogs bd