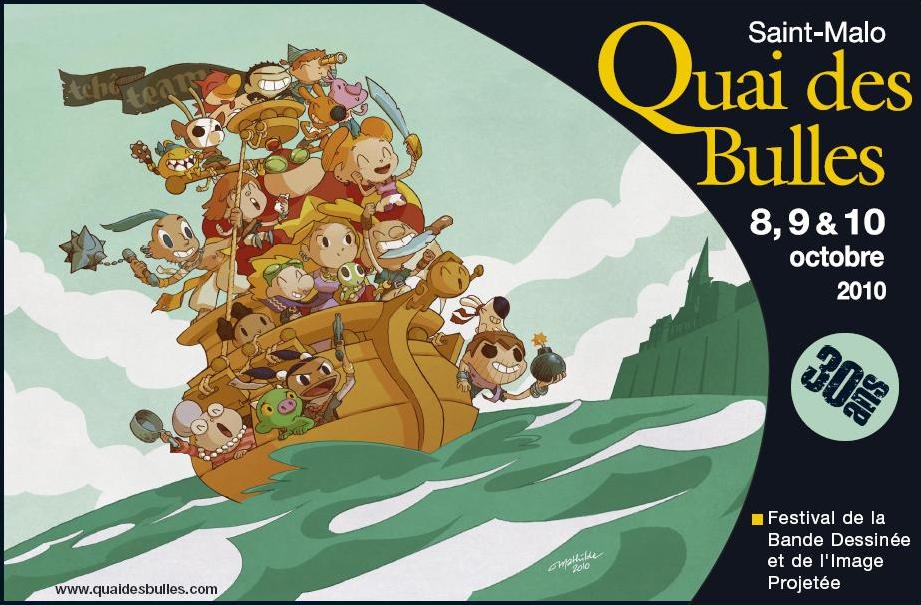De retour de notre table ronde sur la bande dessinée numérique, j’en profite pour faire un peu de publicité au prochain évènement qui aura lieu dans les locaux de l’enssib à Villeurbanne, lui aussi organisé par des collègues conservateurs de bibliothèque. Autour du récent vote de la loi sur le prix unique du livre débattront plusieurs acteurs du circuit de la création littéraire, représentants du syndicat des gens de lettres, de l’interassociation des bibliothécaires et documentalistes, du syndicat de la librairie française et du ministère de la culture. L’occasion d’aborder un autre aspect, législatif celui-là, des évolutions numériques de l’édition. Plus d’information sur le site de l’enssib.
**
Dans le flot des expositions de bande dessinée qui fleurissent depuis quelques années dans des institutions non-dédiées au medium, mon actuelle résidence lyonnaise m’a permis d’aller voir Traits résistants qui est présentée depuis le 31 mars, et jusqu’au 18 septembre, au Centre d’histoire de la résistance et de la déportation (14 rue Berthelot, métro Jean Macé).
Le moment est venu d’en livrer un petit compte-rendu subjectif. Etant en plein dans la rédaction de ma série d’articles sur « exposer la bd à travers les ages », mon fil directeur sera de démontrer à quel point cette exposition récente est une rupture (bénéfique, à mon sens) dans l’histoire des expositions de bande dessinée.
Juste une précision : je n’évoque ici que l’exposition, et pas son catalogue, qui vient peut-être contredire certaines de mes remarques, ou répondre à certaines de mes attentes.
Parcours
Quelques détails pratiques, avant tout. L’exposition a été réalisée conjointement par le Centre d’histoire de la résistance et de la déportation à Lyon (http://www.chrd.lyon.fr/chrd/) et le Musée de la résistance nationale à Champigny-sur-Marne (http://www.musee-resistance.com/). C’est l’archiviste du MRN, Xavier Aumage, qui est le commissaire de l’exposition. Les deux structures, comme leur nom l’indique, sont dédiées à l’histoire de la résistance et conservent des collections de documents d’archives. Sauf erreur de ma part (et n’hésitez pas me corriger là-dessus) elles sont d’origine associative, et non de l’Etat, même si le réseau des MRN est labellisé « musée national » et travaille en partenariat avec les ministères et les archives nationales.
A première vue, l’exposition Traits résistants s’inscrit dans la vogue de l’intérêt croissant des musées et fondations privées pour la bande dessinée. Je me contenterais ici de rappeler les expositions les plus récentes : Les voyages imaginaires d’Hugo Pratt à la Pinacothèque de Paris, Archi et BD à la Cité de l’architecture et du patrimoine, Astérix au musée de Cluny, Moebius Transeformes à la fondation Cartier. Depuis le milieu des années 2000, de nombreuses institutions ont livré à leur public au moins une exposition sur la bande dessinée, l’exercice semblant presque être devenu un passage obligé, parfois pleinement assumé comme un moyen d’attirer un public moins restreint que leurs expositions habituelles (déclaration qui me semble un peu vexante pour la bande dessinée… mais enfin). Ces expositions se succèdent sans pour autant se ressembler, et Traits résistants constitue une nouvelle modalité de l’appropriation de la bande dessinée par une institution culturelle à travers une exposition.
La visite de l’exposition est relativement courte, ce qui n’est pas un défaut à mes yeux, et se déroule sur deux niveaux. Au premier niveau, la traditionnelle grande frise chronologique reprenant les dates importantes du thème : l’image de la Résistance dans la bande dessinée jusqu’à nos jours. Est également présenté à cet étage un « making of » d’un album qui paraît conjointement à l’évènement, Résistances par Jean-Christophe Derrien et Claude Plumail, au Lombard (sorti en juin 2010). Si le CHRD « mime » ici la récente collection « Louvre/Futuropolis », où les albums étaient le fruit d’une collaboration éditoriale entre un musée et une maison d’édition, les liens sont ici moins matériels. L’album s’est nourri des échanges entre le scénariste Jean-Christophe Derrien, à la recherche de documentation pour sa nouvelle série sur la Résistance, et l’archiviste du MRN, Xavier Aumage. C’est à ce titre, comprenons-nous, que l’album figure en bonne place dans l’exposition : le personnel du MRN y a indirectement participé en exhumant tel ou tel document d’archive, ou en apportant un regard scientifique sur les faits évoqués dans la série.
C’est au sous-sol que se situe l’essentiel de l’exposition. Elle est déclinée selon huit axes : un premier axe directement historique : l’image du résistant dans la bande dessinée produite sous l’Occupation, puis sept axes thématiques : l’édification d’un panthéon de héros à la Libération à travers l’image, le traitement du mythe de l’unité de la Résistance, le thème central du « maquis », le thème de la violence, le thème de l’aide aux personnes pourchassées, le thème de la parole libre, la continuation du thème de la Résistance dans des récits de science-fiction. Si le titre précise qu’il sera question de la bande dessinée « jusqu’à nos jours », la majeure partie de l’exposition se concentre sur la production des années 1940-1950 (probablement parce qu’il s’agit d’un moment de forte production autour du thème de la Résistance), même si des bandes dessinée ultérieures viennent occasionnellement ponctuer les grands thèmes. Ce n’est qu’au passage qu’est traité, par exemple, le thème de la remise en cause du mythe résistancialiste à partir des années 1970, dont Le Sursis de Jean-Pierre Gibrat est un excellent exemple, certes un peu tardif (1997), avec son héros ni résistant ni collabo.
A rebours
D’emblée, il me semble utile de préciser que cette exposition n’est pas une exposition sur la bande dessinée [nota : le catalogue, en revanche, est davantage axé sur la bande dessinée]. C’est une exposition sur « l’image de la résistance dans la bande dessinée ». Vous me direz : le titre l’indique d’une façon suffisamment claire. Mais si je le précise, c’est que le fil directeur de l’exposition est bien « l’image de la Résistance », ce que traduit le choix des thèmes. On se trouve ici dans une situation exactement inverse à celle d’Archi et BD, pour donner un exemple que j’ai déjà traité sur ce blog. Dans Archi et BD, le thème était avant tout la bande dessinée, la majorité des objets proposés était de la bande dessinée, et l’architecture n’était qu’incidemment exposée (par quelques croquis d’architectes, en l’occurence). Le découpage choisi se faisait en fonction de l’histoire de la bande dessinée (les années 1920, puis « l’âge d’or belge » des années 1950, puis les auteurs contemporains), ce qui n’était pas sans créer une sorte de confusion, d’ailleurs. L’exposition Traits résistants traite elle d’une parcelle de l’histoire de la Résistance (ou plutôt de l’histoire de l’image de la Résistance), la bande dessinée n’étant qu’un filtre spécifique.
Je serais bien tenté d’expliquer cette approche par les contextes d’élaboration respectifs des deux expositions. Archi et BD est dirigée par Jean-Marc Thévenet, acteur du monde de la bande dessinée aux multiples casquettes depuis les années 1980 (scénariste, rédacteur en chef, scénographe, directeur de collection, directeur scientifique du festival d’Angoulême…). Si Jean-Marc Thévenet a pu compter sur le soutien de François de Mazières, président de la Cité de l’architecture, et sur la collaboration de Francis Rambert, directeur de l’Institut français de l’architecture, l’exposition est à l’origine un projet externe à l’institution qui l’accueille. Cette externalité se traduisait, à mes yeux, par des lacunes en terme d’histoire de l’architecture : il y avait davantage juxtaposition que dialogue entre les deux parties du titre, comme si les conservateurs de la Cité de l’architecture n’avaient pas voulu participer et « jouer le jeu » à ce qui allait être leur meilleur score de la saison en terme d’entrées. Traits résistants est au contraire dirigée par un archiviste, Xavier Aumage qui est d’abord un historien de la Résistance, même s’il s’est intéressé dans son parcours universitaire à la littérature pour la jeunesse. Il n’est qu’incidemment amateur de bande dessinée, et ne s’en prétend pas spécialiste. En revanche, l’exposition qu’il réalise est interne aux deux centres (CHRD et MRN) et à leurs préoccupations : dresser l’histoire de l’image de la Résistance (un choix qui fait écho à l’exposition permanente du CHRD). Mine de rien, et même s’il faudrait préciser cette remarque, il s’agit d’un cas unique dans l’histoire des expositions de bande dessinée. Jusque là, elles étaient le fruit d’acteurs extérieurs aux institutions qui les abritaient, l’exemple emblématique étant celui de la Bibliothèque nationale de France qui, en 2000, doit faire appel à Thierry Groensteen et à l’expertise du CNBDI pour diriger l’exposition sur les Maîtres de la bande dessinée européenne. Cette fois, c’est enfin un membre de l’institution qui prend en charge l’exposition. A ce titre, j’irais jusqu’à dire que Traits résistants fait date, à une échelle certes réduite mais essentielle, puisqu’elle est le signe d’une intégration de moins en moins artificielle de la bande dessinée aux institutions muséales.
Ce retournement de perspective se traduit concrètement dans l’exposition, qui diffère sur plusieurs points des codes traditionnels des expositions de bande dessinée.
La rupture la plus nette tient aux objets exposés. Là où les commissaires d’expositions de bande dessinée ont en général toutes les peines du monde à trouver des objets et doivent aller piocher dans les fonds de collectionneurs privés, cette source, sans être ignorée, est limitée dans Traits résistants. La conséquence directe est que les amateurs de planches originales risqueront fort d’être déçus : il n’y en a quasiment pas, à l’exception notable de celles de La bête est morte de Calvo, ainsi que celles de l’album Résistances qui accompagne indirectement l’exposition. Ainsi est pris à rebours une quarantaine d’années d’expositions de bande dessinée érigeant la planche originale comme objet privilégié. On sent ici que le commissaire d’exposition n’est pas issu du monde de la bande dessinée, ce qui est profondément rafraîchissant et permet de rompre avec une pratique ancienne et à mon sens peu rationnelle car relevant d’un rapport émotionnel à la bande dessinée (proche en cela du fétichisme de la dédicace ; le règne de la planche originale toucherait-il à sa fin ?). Mais qu’est-ce qui est exposé, alors, me demanderez-vous ? On trouvera principalement deux types d’objets. Soit des bandes dessinées prises dans leur matérialité, en revue ou en album, soit des fac-similés de planches. La provenance des pièces est le MRN, le CIBDI, ou la bibliothèque municipale de Lyon. Il est heureux de prouver qu’on peut faire une exposition de bande dessinée sans en appeler aux collectionneurs. Le MRN a la chance de posséder dans ses fonds de nombreuses revues d’époque publiant des bandes dessinées, et cette richesse a été exploitée ici. En outre, beaucoup d’objets présentés ne sont pas des bandes dessinées mais servent à mettre les productions graphiques en regard du reste des documents de l’histoire de la Résistance.
Une seconde rupture tient à la nature même de l’exposition. Traits résistants appartient à une catégorie rare : l’exposition scientifique de bande dessinée. A l’exception de Maîtres de la bande dessinée européenne, les expositions de bande dessinée au contenu scientifique pointu étaient rares en-dehors du CIBDI (qui peut faire appel à son équipe de chercheurs et spécialistes). La traduction de cette ambition scientifique est son catalogue qui propose plusieurs études sur le sujet. Un comité scientifique a été réuni et l’exposition est là pour mettre en valeur des fonds d’archives, plutôt que des oeuvres d’art. Si son sujet est l’image de la Résistance, l’histoire de la bande dessinée transparaît de façon périphérique mais sérieuse. Fort heureusement, la plupart des idées reçues sur la bande dessinée sont soigneusement évitées (ouf, il n’est question nulle part du « passage à l’âge adulte » des années 1960 !) et des sujets d’étude peu courants sont abordés (les petits formats notamment, parents pauvres de l’histoire de la bande dessinée) ou abordés d’une manière originale qui évite le passage obligé par des chefs-d’oeuvre (pour le domaine belge, on s’intéresse à Wrill plutôt qu’aux habituels Tintin et Spirou). On recherche la pertinence des exemples plutôt que les grands exemples que tout le monde connaît. Surtout, l’ambition scientifique se lit dans les analyses d’image proposées. Elles font appel aux méthodes d’analyse par mise en contexte de la production jusqu’à la réception, soulignant qu’une oeuvre d’art n’est pas une création immanente et géniale détachée de tout contexte. D’ailleurs, on voit ici que la bande dessinée n’est pas considérée en terme de « chef d’oeuvre », selon ses qualités plastiques, mais comme un document historique comme un autre, pour sa capacité à refléter les attentes de la période. Cela aussi est rafraîchissant dans une exposition de bande dessinée.
Bon… A lire cet article, on aurait l’impression que je n’ai pas de reproches à faire à cette exposition… Un petit, tout de même : paradoxalement, l’exposition elle-même propose une vision parfois un peu trop univoque de la Résistance. Je signalais au début que la période de remise en cause du résistancialisme était peu abordée. Cela pouvait s’expliquer par le fait que la bande dessinée a finalement assez peu ressenti ce choc (beaucoup moins que le cinéma), ou l’a ressenti avec beaucoup de retard. Mais il est amusant de constater que le mot de « propagande » n’est jamais utilisé à propos des oeuvres relevant justement du mythe résistant, La bête est morte étant l’exemple le plus flagrant. « Propagande » est pourtant employé quand il s’agit de parler des oeuvres produites au service de l’occupant nazi, ou du gouvernement de Vichy, avec cette distinction de « propagande officielle » qui laisse supposer qu’il existerait une propagande « non-officielle ». C’est justement celle de la Résistance, qui utilise des principes proches de son homologue allemande, et notamment la stigmatisation outrancière de l’adversaire : dans La bête est morte, on explique au lecteur que les allemands sont par nature des êtres barbares. Les thèmes mis en avant dans les illustrés pour enfants après la Libération, glorifiant la Résistance, sont aussi le fruit d’une propagande qui tente de construire, après la guerre, ce qui relève d’un mythe, en inculquant aux jeunes l’image manichéenne de gentils résistants luttant contre d’infâmes et stupides allemands. Ce simple fait, qui conditionne pourtant la création de séries comme Fifi gars du maquis ou Les trois mousquetaires du maquis n’est pas clairement exprimé, m’aura-t-il semblé.
C’est un reproche qui reste limité et je vous encourage, amis lyonnais, à vous rendre au CHRD pour aller voir Traits Résistants.