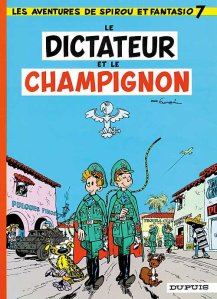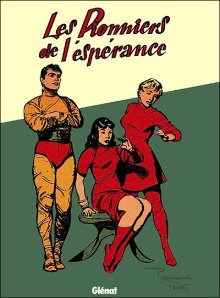Années fastes s’il en est pour la science-fiction qui profite à de l’explosion créatrice qui secoue toute la bande dessinée. N’oublions pas que la plupart des séries déjà évoquées dans cette série d’articles se poursuivent inlassablement dans leur support d’origine : Les Pionniers de l’Espérance dans Vaillant, Les Naufragés du temps dans France-Soir et les albums de Barbarella continuent de paraître chez Eric Losfeld. Quant à l’école belge, jusque là plutôt rêtive à la science-fiction pure et la préférant diluée, ou à la rigueur jacobsienne connaît un changement d’orientation. Dans Le Journal de Tintin, le lancement en 1967 de Luc Orient par Eddy Paape constitue les premiers pas du journal dans la SF type Flash Gordon. Même chose avec l’arrivée dans les pages de Spirou du Yoko Tsuno de Roger Leloup qui combine les motifs classiques de la science-fiction avec l’hyperdocumentation et l’aventure jacobsienne, ainsi qu’une précision scientifique qui nous rappelle que depuis Jules Verne, la science-fiction sert aussi à apprendre la science aux enfants. Cette série est suivie de près par le plus humoristique Scrameustache de Gos en 1972, comme si la seconde génération de dessinateurs arrivant dans ce journal se sent davantage prêt à gérer des récits de science-fiction. Quelques intrigues science-fictionnelles font aussi leur entrée dans certaines séries de l’âge classique comme Spirou et Fantasio et Ric Hochet. Sans compter l’essor de Valerian agent spatio-temporel dans Pilote à partir de 1967. Partant du space opera traditionnel, ses deux auteurs, Pierre Christin et Jean-Claude Mezières en renouvellent à la fois le graphisme et les thématiques, en exploitant notamment à merveille le principe du voyage dans le temps et en abandonnant le réalisme forcené au profit d’un style plus souple. Le même Pilote accueille à partir de 1978 Le Vagabond des Limbes de Julio Ribera et Christian Godard, une série ayant été directement publiée en album, puis dans Circus et Tintin. Pilote joue un rôle d’autant plus important dans la diffusion et la diversification de la bande dessinée de science-fiction puisqu’on n’y retrouve aussi Lone Sloane de Philippe Druillet.
Dans ce foisonnement, il me fallait bien choisir deux titres et un fil directeur. Le plus évident est sans doute de suivre les premiers pas de la revue Métal Hurlant qui, dès sa création en 1975, s’attache à concentrer le meilleur de la science-fiction graphique qu’elle range définitivement au sein de la culture adulte. Même en se limitant à cette revue, les titres et les auteurs sont innombrables. Mon choix s’est porté sur Druillet et Moebius, sans doute les symboles les plus connus de la rénovation de la science-fiction, et tout particulièrement sur deux de leurs oeuvres parues dans les pages de Métal Hurlant : Gail pour Druillet et Le garage hermétique de Jerry Cornelius pour Moebius. Comme d’habitude, vous n’aurez aucun mal à trouver ces titres chez votre libraire, car ils sont respectivement réédités par Albin Michel pour le premier et par Les Humanoïdes Associés pour le second.
Métal Hurlant et la science-fiction : un moment de prestige et de symbiose pour la science-fiction graphique française

La science-fiction est, avec l’humour, le genre qui sert de tremplin privilégié pour l’approfondissement de la bande dessinée adulte. Barbarella et Les Naufragés du temps avaient préparés le terrain. Pendant que Gotlib, Mandryka, Brétécher et leurs collègues humoristes partent fonder de multiples journaux et explorer les terres inconnues de l’humour, c’est vers d’autres mondes que se dirigent deux autres transfuges de Pilote, Philippe Druillet, Moebius.
Pour comprendre ce qui se passe avec la création de Métal Hurlant en 1975, il faut d’abord en revenir à Pilote, cette revue qui fut, autour des années 1970, un étrange laboratoire pour la bande dessinée française, cherchant dans de multiples directions de nouvelles manières d’utiliser les codes de la narration graphique. Dans le domaine de la science-fiction, Jean-Claude Mezières et Pierre Christin ont commencé leur Valerian dès 1967 qui poursuit sa course dans les années 1970, éditée en albums. En 1972, Jean-Claude Forest, renovateur de la science-fiction dans laquelle il injecte sa fantaisie et son délire, arrive dans le journal avec Hypocrite qui ne trouve cependant pas son public et disparaît en 1974. Puis, Druillet et Moebius poussent encore plus loin les recherches, aidés en cela par d’autres auteurs comme Enki Bilal, Caza et Jean Solé. Tous sont au sommaire d’un numéro « spécial science-fiction » en 1975 qui prouve que le genre a pénétré le journal avec succès et est suffisamment porteur. Un autre spécial science-fiction paraîtra en 1977.
Les profils de Druillet et Moebius, quand ils se lancent dans la science-fiction dans Pilote sont sensiblement différent. Le premier se consacre au genre depuis les années 1960 et, dès son arrivée avec Lone Sloane en 1970, il impose un style puissant qui bouleverse les habitudes de la bande dessinée : les cases sont pulverisées, certaines pages ne sont qu’une seule grande illustration… Surtout, sa science-fiction s’affirme tout de suite comme un monde mystique et grandiose. Au contraire, Moebius est un habitué de Pilote pour lequel il travaille sous son vrai nom, Jean Giraud, depuis 1963 sur la série Blueberry, western scénarisé par Jean-Michel Charlier. Lui aussi entend explorer les possibilités de la bande dessinée et Pilote lui en laisse l’occasion. Il y dessine La déviation en 1973, oeuvre-manifeste de son lyrisme graphique qui est considérée comme le tournant de sa carrière, le passage de Giraud à Moebius. Car c’est bel et bien entre les pages de Pilote qu’il fait naître son propre univers de science-fiction, par petites touches, dans quelques récits complets dont L’homme est-il bon en 1974 ou dans une série de fausses chroniques absurdes intitulées Les merveilles de l’univers.
La création de Métal Hurlant en janvier 1975 est l’aboutissement de la fermentation qui se produit dans ce qui n’est qu’en apparence un journal pour enfants. Métal Hurlant, au contraire, est « reservé aux adultes », comme l’indique sa couverture. Ici, un pas est franchi. Outre Moebius et Druillet, on trouve à l’origine de sa création deux autres personnalités : Bernard Farkas et Jean-Pierre Dionnet. Dionnet est arrivée en même temps que Druillet à Pilote comme scénariste, notamment du dessinateur Solé sur la série psychédélique Jean Cyriaque. Redacteur en chef de la revue jusqu’aux années 1980, il y joue un rôle essentiel. A la revue vient s’ajouter, selon les normes de l’époque, une maison d’édition qui permettra d’éditer des albums, les Humanoïdes associés.
Avec Métal Hurlant, la bande dessinée de genre connaît un important renouvellement en devenant le terrain de jeu de nombreux dessinateurs qui font varier tant les univers que les intrigues et les narrations. Les deux modèles dominants depuis les années 1930, le space opera façon Flash Gordon et le merveilleux scientifique d’inspiration vernienne, sont dépassés par l’arrivée de nouveaux modèles qui proposent une nouvelle imagerie de la science-fiction. Métal Hurlant accueille avec Les Naufragés du temps, que Paul Gillon poursuit seul, un souvenir du space opera qui trouvera d’autres occasions de se développer, d’autres réinterprétations sans fin.
Druillet et Moebius sont, chacun de leur côté, les principaux promoteurs de cette nouvelle façon de concevoir la science-fiction en bande dessinée. Ils sont loin d’être seuls sur ce chemin. Métal Hurlant fait débuter François Shuiten avec Aux médianes de Cymbiola en 1979, la même année qu’elle accueille la série post-apocalyptique d’Hermann, Jeremiah ; elle voit s’affirmer la prolixité du scénariste Alejandro Jodorowski, pilier du journal durant les années 1980, largement spécialisé dans de grands cycles de science-fiction ou de fantasy. Le grand changement tient aussi à la connaissance que ces auteurs ont des évolutions de la science-fiction américaine depuis les années 1950. L’influence d’auteurs comme Ray Bradbury, Robert Heinlein ou Michael Moorcock est perceptible dans les couvertures, tout autant que celle d’une science-fiction plus ancienne issu des pulps des années 1930. Au sein du journal se concrétise un rapprochement entre science-fiction et fantasy : d’importants auteurs se dévoilent, en particulier Jean-Claude Gal avec Les armées du conquérant, présent dès le premier numéro.
Là est l’autre apport de Métal Hurlant : au sein de ses pages se forge une culture partagée entre les auteurs et les lecteurs qui mélange, outre le goût pour la littérature de genre (SF, fantasy, polar) qui a droit à des pages de critiques, une passion pour le cinéma et la musique rock que l’arrivée de Philippe Manoeuvre en 1978 ne fait qu’accentuer. Lui et Dionnet sont des personnalités-passerelles, qui font le lien entre la bande dessinée et d’autres médias. Au sein de ce journal se développe l’étrange concept mal défini de « bd rock » : de nombreuses séries reflétent la passion de leurs auteurs pour la musique (Margerin, Ptiluc, Dodo et Ben Radis, Serge Clerc, Jano). Si la notion de BD rock est surtout un concept commercial qui, encore dans les années 2000, inspire les éditeurs de bande dessinée, elle montre aussi comment, dans ces années 1970, la bande dessinée s’intègre à une plus vaste culture adulte, certes marginale, mais incontestablement dynamique, qui lui permet d’avoir une tribune dans la presse non-spécialisée ou à la télévision. Au sein de Métal Hurlant, la bande dessinée va voir du côté de la littérature, du cinéma, de la musique ; une symbiose que d’autres revues de bande dessinée tenteront de reproduire dans les années 1980 pour attirer des lecteurs (L’Echo des savanes, Pilote).
Enfin, Métal Hurlant est, grâce à son édition américaine, Heavy Metal, l’exportateur de la science-fiction française à l’étranger. La bande dessinée française influence cette fois les créateurs américains, et la boucle se trouve bouclée.
Gail de Philippe Druillet, 1977

Gail est, en 1977, la première aventure de Lone Sloane que Druillet réalise spécialement pour Métal Hurlant. Il s’approprie ainsi le jeune journal, en fait son nouveau terrain de jeu : l’année suivante, il adapte en bande dessinée Salammbô de Gustave Flaubert et y fait à nouveau intervenir son personnage fétiche. Le cycle de Lone Sloane connaît une diffusion complexe, au gré des collaborations de Druillet. Il naît en 1966 au sein de la maison d’édition d’Eric Losfeld, celle-là même qui publie le Barbarella de Forest, avec d’autres albums marqués par l’esthétique psychédélique qui triomphe à la fin des années 1960 (Jodelle de Guy Peellaert, La saga de Xam de Nicolas Devil, Kris Kool de Caza). S’inscrivant dans ce moment éphémère de la bande dessinée, il apporte au média un affranchissement des règles traditionnelles. Gail en est un très bon exemple, où la composition des pages n’obéit pas aux normes habituelles. Les cases disparaissent au profit de vignettes juxtaposées aux sens de lecture multiples, et ce sont bien souvent les corps, la calligraphie stylisée ou l’architecture (c’est-à-dire les composantes mêmes de l’image, et non un découpage externe) qui délimitent les séquences. Plusieurs pages lorgnent du côté du roman illustré, avec leur pavé de texte qui accompagne une image hiératique, tandis que Druillet n’hésite pas à transformer une page, voire une double page, en une seule grande illustration aux dimensions démesurées.
Sans doute faut-il signaler ici que Druillet a commencé dans le domaine de l’image par la photographie et l’illustration de romans de science-fiction. Son goût pour la puissance de l’image unique, par opposition à l’image « narrative » du langage de la bande dessinée (qui se donne à lire plus qu’à voir) lui permet d’apporter une inspiration nouvelle. Certaines cases sont de véritables tableaux (tels la représentation de « l’île », imitée du tableau L’île des morts d’Arnold Böcklin (1886). L’invention d’architectures fantaisistes est une de ses spécialités. En 1978, une exposition a lieu où il expose plusieurs planches, conçues à la fois comme s’intégrant à une histoire, et comme susceptibles d’être admirée pour elles-mêmes. Ce faisant, il ouvre la voie à des Bilal, des Moebius et des Blutch qui exposeront aussi dans des galeries pour poursuivre une double carrière complémentaire d’illustrateur et de dessinateur de bande dessinée, l’une nourrissant l’autre et inversement. La tension de Druillet vers l’illustration et la peinture se poursuit dans le reste de sa carrière : il réalise des affiches de films (La guerre du feu en 1981). Il s’étend encore jusqu’aux clips vidéo (Excalibur de William Sheller en 1990) et au décor de téléfilm (pour la reprise des Rois maudits en 2005). Il fait également partie des premiers auteurs de bande dessinée dont les dessins sont mis aux enchères.
Dans Gail, pourtant, Druillet s’est un peu assagi par rapport à ses premiers Lone Sloane, ceux qui paraissent dans Pilote à partir de 1970. Peut-être au contact d’autres dessinateurs de bande dessinée, il combine son art d’illustrateur avec un travail de conteur, répugnant moins qu’avant aux pages entières de dialogue, plus traditionnelles. L’intrigue reste volontairement absconse, comme dans les autres épisodes du cycle. Le narrateur cache sans cesse des éléments de compréhension au lecteur, faisant du monde futuriste de Sloane un univers clos et hermétique, atteignable par les seuls initiés. Il y a, chez Druillet, une pointe de mysticisme dont on ne sait pas toujours très bien s’il s’agit de second degré ou non. Ainsi, Sloane, ayant perdu ses pouvoirs à l’étendue démesurée, est fait prisonnier sur Sainte-Marie-des-Anges, la planète-prison. Au cours de son incarcération, il se « réveille » mystérieusement, retrouve ses pouvoirs, et provoque une révolte sur la planète qui devient alors le lieu d’affrontement entre l’empereur Shaan et son vassal Merennen, le tyran de la planète Gail. Mais Sloane comprend que son réveil n’est pas le fruit du hasard et qu’il est manipulé par des forces supérieures. Ce thème du champion errant surpuissant qui lutte contre des « dieux » qui veulent en faire leur bras armé semble provenir directement du Cycle d’Elric de Michael Moorcock, un auteur que Druillet admire et dont il a illustré de nombreux romans. Chez Moorcock comme chez Druillet, tout est mis en oeuvre pour que le lecteur comprenne qu’il lui manque des clés de lecture et que l’univers décrit est mille fois plus complexe qu’il n’y paraît. C’est d’ailleurs cette liberté, potentiellement illimitée, qui autorise Druillet à transporter Sloane dans le Carthage de Salammbô.
L’intrigue, chez Druillet, se trouve absorbée par l’univers dessiné. Nous n’assistons à chaque fois qu’à un bref épisode d’une immense saga que nous ne lirons jamais. Il faut dire que l’esthétique de Druillet est profondément intimidante, que ses effets sont peu subtils, puissants, et sans concession. Les bâtiments ne sont pas à taille humaine mais à taille cosmique ; les personnages sont pour la plupart des extraterrestres difformes ou des robots (Sloane devient alors le dernier représentant de la race humaine) ; les couleurs sont saturées et excessives. La science-fiction que nous propose Druillet ne fait pas référence au réel, encore moins à la science réelle ; ses références sont purement imaginaires : ce sont des tableaux, des univers romanesques ; il n’y a plus rien d’humain, ou du moins l’humain tel que nous le connaissons n’est plus en mesure de dominer son monde. C’est peut-être là que Druillet fait franchir à la science-fiction un pas important, largement inspiré par les évolutions récentes du genre tel le Dune de Frank Herbert (1965). L’oeuvre de Druillet n’a pas changé de fond en comble l’esthétique du média, mais il a montré qu’une histoire en bande dessinée pouvait être « autre chose », et se nourrir d’autres influences que les siennes propres.
Le Garage hermétique de Jerry Cornelius, Moebius, 1976-1979

Si c’est par une esthétique fracassante que Druillet bouleverse les codes de la bande dessinée, l’intervention de Moebius, tout aussi déterminante, est pourtant plus subtile. Peut-être plus que Druillet encore, Métal hurlant est pour lui, enfin, l’espace où il peut s’épanouir et concevoir une bande dessinée qui réponde à ses propres désirs et à ses propres attentes telles qu’elles avaient pu apparaître dans Pilote à travers La déviation. Ce sera d’abord Arzach, récit devenu célèbre en tant que prouesse graphique, puisque, pour raconter les aventures d’un étrange cavalier, il fait le choix d’une bande muette de 35 pages. Et puis ce sera Le garage hermétique de Jerry Cornelius, histoire de plus de cent pages s’étendant sur trois ans de publication (1976-1979). Dans Le garage hermétique, Moebius donne une consistance inédite à son propre univers de science-fiction et fait preuve d’une liberté narrative nouvelle.
Moebius imagine Le garage hermétique comme un récit spontané. A l’origine, quelques planches qui n’étaient pas destinées à être publiées et qui enthousiasment suffisamment Dionnet pour qu’il en demande une suite. De 1976 à 1979, Moebius réalise pour chaque numéro de Métal Hurlant un nouvel épisode de cette histoire, en marge de ses autres travaux. Pas de plan prédéfini, pas de scénario : Moebius ignore complètement où il veut en venir et improvise tous les mois le nouvel épisode. Dans ces conditions, difficile de vous résumer l’histoire du Garage hermétique. On y voit évoluer une galerie de personnages, dont Jerry Cornelius et le Major Grubert, dans un monde appelé « le Garage hermétique » dont on apprend dans les premiers épisodes que Grubert est le créateur, une sorte de dieu immortel à l’apparence humaine. L’arrivée de Jerry Cornelius dans son univers est une menace pour le Major qui se met en chasse du nouveau venu. Le Major est un vieux personnage de Moebius, déjà présent dans quelques courtes histoires, mais c’est dans Le Garage qu’est révélé son statut de démiurge.
Moebius explique lui-même dans la préface de l’album, qui sort en 1979 aux Humanoïdes Associés, qu’il lui arrivait d’oublier le contenu de l’envoi précédent ou de réaliser le dernier épisode dans la précipitation, en une nuit. Pire encore, lorsque l’intrigue commence à se préciser, il la détruit sans cesse pour partir sur autre chose, inventer de nouveaux personnages ou un rebondissement. On comprend qu’une telle histoire n’aurait pas pu se faire chez des éditeurs traditionnels, Dupuis, Le Lombard et Dargaud : Le garage n’est pas pensé pour être calibré en album, encore moins pour constituer une série avec des personnages récurrents. Il défait la notion d’intrigue. Il n’est préparé par aucun scénario et guidé seulement par la désinvolture, que l’on peut aussi appeler la liberté. Cela, déjà, à quelque chose de révolutionnaire. Par cette oeuvre, Moebius introduit dans la bande dessinée l’idée de liberté créatrice de l’auteur, hors de toute entrave, qu’elle provienne de l’éditeur, du public, ou de la tradition.
L’art de Moebius dans cette oeuvre naît aussi d’un maniement des codes de la science-fiction, la plupart du temps sur le mode parodique, ce qui donne au Garage un aspect dérisoire à défaut d’être comique. L’habitué de science-fiction n’est donc pas surpris de certains mots étranges employés pour décrire des objets ou des réalités n’existant pas dans notre monde. L’histoire semble parfois faite de la juxtaposition de cases-clichés directement issues de BD de science-fiction (voir la reprise du modèle américain du superhéros dans les derniers épisodes), tandis qu’à d’autres instants, c’est le western qui s’invite dans l’histoire, souvenir de la série Blueberry, de ses duels et de ses plaines désertiques. Bien que très libre, Le Garage est une oeuvre profondément référentielle, qu’on y fasse appel à des oeuvres extérieures, à des clichés narratifs et graphiques (la femme fatale, les jeux de pouvoir et de trahison…) ou à des motifs propres à l’oeuvre antérieure de l’auteur. Tout à fait lisible au second degré, Le Garage raille bien souvent, pour mieux s’en servir sur un ton détaché, les chevilles classiques du genre, comme lorsque le troisième épisode se termine sur un « Vous le saurez bientôt en lisant Star Billard, notre prochain épisode ». Mais si humour il y a chez Moebius, c’est un humour profondément absurde qui fait passer les incohérences pour de la fantaisie, et les clichés pour de l’ornement narratif.
Au-delà du fait de traiter sur le mode de la dérision les codes de la science-fiction, d’autres éléments sont autant de moyens de briser les codes de la bande dessinée pour les remplacer non par d’autres codes mais par la liberté créatrice de l’auteur. Ce n’est pas, comme chez Druillet, par le graphisme que Moebius innove le plus. Quoique. Sa doctrine en la matière dans Le garage, mais aussi dans de nombreuses autres oeuvres, est que le style a le droit de changer. Il ne s’en prive pas ici et le Major, notamment, fait les frais des caprices de l’auteur et subit plusieurs transformations graphiques. Le trait se fait parfois précis et fourmillant de détails, mais aussi plus souple et épuré lorsque cela est nécessaire.
Mais c’est sur le plan narratif que Moebius accomplit son travail de dynamiteur. Le Garage n’a donc pas de scénario, l’oeuvre est improvisée au fil du crayon et, comme l’annonce le résumé d’un des épisodes « Tout peut encore arriver dans le garage hermétique ». L’histoire change constamment et s’amplifie de plus en plus de nouvelles ramifications. Moebius multiple les procédés qui déstabilisent l’intrigue traditionnelle : des dialogues absurdes, des ellipses narratives inattendues qui pousse le lecteur à découvrir une nouvelle partie du Garage hermétique, l’apparition constante de nouveaux personnages, des hommes qui deviennent des femmes, des fils narratifs qui se terminent en queue de poisson… L’aléatoire semble parfois intervenir dans la conduite du récit. Le narrateur qui intervient parfois ne se gêne pas pour donner ses avis et ses jugements sur l’histoire.
Pour Moebius, le genre « science-fiction » joue un rôle essentiel : « J’aime la science-fiction parce qu’elle ouvre en grand les portes de l’espace et du temps et surtout parce qu’elle me permet d’aborder de façon très directe mes préoccupations essentielles. ». Cette conclusion était déjà celle des créateurs de Flash Gordon qui prenait pretexte à l’exploration de nouveaux mondes pour déplacer leur héros dans le temps. Moebius la pousse à son maximum, au détriment de la cohérence. Il n’est pas innocent que se soit la science-fiction qui ait déclenché la création du Garage hermétique.
Et en conclusion, il nous faut une fois de plus revenir au romancier Michael Moorcock qui marque les années 1960. D’abord parce que le titre de l’histoire de Moebius fait explicitement référence à un personnage créé par Moorcock en 1968 dans le récit The Final Program. Ce personnage a été réutilisé, avec l’approbation appuyée de Moorcock, par d’autres auteurs. Cornelius serait donc une sorte de « personnage ouvert » susceptible d’être transposé dans un autre univers de fiction que celui propre à son créateur. Et puis surtout, Moorcock est l’un des auteurs à avoir le mieux exploité dans son oeuvre (qui mêle, rappelons-le, science-fiction et fantasy) la notion de « multivers », hypothèse qui veut que notre univers ne soit qu’un « univers possible » parmi une infinité d’autres mondes parallèles existant en même temps. Exploitant à fond cette notion, Moorcock fait voyager ses héros, (Elric, Hawkmoon, Bastable) dans le temps et dans l’espace et dans des versions alternatives de notre monde. Pour un auteur, la notion de multivers permet par exemple d’expliquer l’interaction entre les différents univers et personnages qu’il a crée. Dans Le Garage hermétique, Moebius s’en donne lui aussi à coeur joie, puisque le monde du Garage n’apparaît qu’être un univers inventé de toutes pièces par le Major qui le surveille depuis son vaisseau spatial, le Ciguri. Le monde du Garage hermétique est donc un monde imaginaire où tout est potentiellement possible.
De là à dire que Le Garage hermétique est une histoire qui a pour sujet principal la création et la manière dont un créateur (ici aussi bien le Major que Moebius lui-même) tente de maîtriser l’univers qu’il a engendré, il n’y a qu’un pas, que je franchis d’autant plus allègrement au vu des conditions de création de l’oeuvre, cette force d’improvisation qui offre à l’auteur une liberté de choix maximum. L’apparition d’un récit sur la création montre qu’avec Moebius, la bande dessinée a atteint une très grande maturité, puisqu’elle se montre capable d’évaluer et de tester sa propre capacité imaginaire.
A suivre : années 1980, recueil Social Fiction de Chantal Montellier ; La fièvre d’Urbicande, de François Schuiten et Benoît Peeters
Pour en savoir plus :
Philippe Druillet, Gail, l’édition originale de 1978 est auto-éditée ; Albin Michel, 2000 pour la dernière édition
Moebius, Le garage hermétique de Jerry Cornelius, l’édition originale de 1979 a pour titre Major Fatal; Humanoïdes associés, 2006 pour la dernière édition
Le site de Philippe Druillet : http://www.druillet.com/
Le site de Moebius (qui prépare visiblement une exposition à la Fondation Cartier) : http://www.moebius.fr/
Les analyses et réflexions sur Métal Hurlant sont en partie tirées de :
Thierry Groensteen, La bande dessinée, son histoire et ses maîtres, CIBDI, 2009
Serge Clerc, Le Journal, Denoël graphic, 2007