Après un petit tour du côté des expos de la première moitié du XXe siècle, j’en arrive à une exposition souvent considérée comme fondatrice : « Bande dessinée et figuration narrative » qui s’est tenue en 1967 au musée des Arts Décoratifs. Assez peu d’exposition de bande dessinée oublient de s’y référer en introduction comme la « première » exposition de bande dessinée ou, mieux, à « l’entrée de la bande dessinée au musée ». C’est tout naturellement que la bibliographie la concernant est relativement importante (du moins à l’échelle du sujet qui m’occupe dans cette série). Pour ceux qui ignoreraient tout de l’expo de 1967, ou ceux dont la mémoire a besoin d’être rafraîchie, je vous invite à aller consulter un article de Pierre-Laurent Daures qui en présente les principaux enjeux et qui a interrogé la scénographe de l’époque, Isabelle Coutrot-Chavarot.
De mon côté, le défi consiste donc à écrire quelque chose d’original sur le sujet plutôt que de reprendre ce qui a été écrit (ce qui n’est pas facile après Thierry Groensteen !). D’où mon choix de cet angle d’attaque plus précis : jusqu’à quel point l’expo Bande dessinée et figuration narrative est-elle fondatrice, et surtout, que fonde-t-elle vraiment ?
Le contexte de « Bande dessinée et Figuration narrative »
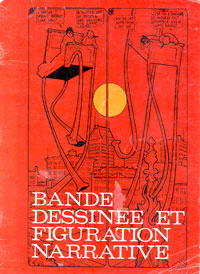
Lorsqu’un événement culturel est vécu comme fondateur, c’est soit qu’il est un des premiers de sa partie, soit qu’il suppose un changement tel qu’il introduit un nouveau paradigme. Faisons l’essai pour l’exposition « Bande dessinée et Figuration narrative » : qu’elle soit la première exposition de bande dessinée n’est pas complètement vrai ; mon article précédent était là pour démontrer le contraire. En revanche, il est tout à fait juste de dire qu’elle introduit deux modifications essentielles dans la conception des expositions de bande dessinée :
1. Pour la première fois, des oeuvres de bande dessinée sont exposées pendant plus d’une semaine dans l’enceinte d’un musée national. Même s’il ne s’agit pas d’un musée des Beaux-Arts, mais d’un musée des Arts décoratifs (ne s’intéressant justement pas dans ladite catégorie des « beaux-arts », mais s’attachant à des arts plus triviaux dans leur usage), ces oeuvres sont exposées dans le but d’être comparées avec des peintures (celle du mouvement qui s’est appelé « Figurative narrative »), certainement celui des Beaux-Arts le plus respecté à cette époque. Indirectement, cela implique aussi que l’Etat reconnaît une légitimité artistique, encore toute relative, à la bande dessinée.
2. Les expositions de bande dessinée cessent pour un temps d’être le fruit des auteurs eux-mêmes, qui vont être atteints par une méfiance envers l’institution muséale officielle jusqu’aux années 1990. Les années 1960 marquent le départ d’une appropriation de l’organisation d’expositions par une catégorie spécifique d’acteurs : les fans, en d’autres termes des spécialistes érudits amateurs de bande dessinée, en marge du circuit institutionnel du monde des musées, et souvent même en marge du monde de l’art. Pour plusieurs décennies (et encore maintenant, même si la situation s’est largement diversifiée), le montage d’exposition de bande dessinée va être un outil au service du discours fanique.
En effet, à l’initiative de « Bande dessinée et Figuration narrative » se trouve l’une des associations composant le fandom nostalgique de la bande dessinée : la Socerlid (Société civile d’études et de recherches sur les littératures dessinées, 1964). Cette dernière est une scission d’un groupe plus ancien, le CBD (Club des bandes dessinées, 1962, devenu CELEG en 1964), et l’exposition remplit donc deux objectifs à court et à long terme. D’une part, il s’agit de prendre de vitesse le CELEG en devenant l’association la plus active et la plus visible du grand public (de fait, l’organisation de l’exposition, qui marque le triomphe de la SOCERLID, et la fin des activités du CELEG ont simultanément lieu durant le premier semestre 1967) ; d’autre part, il s’agit d’oeuvrer pour la « légitimation » de la bande dessinée, avec comme sous-entendu que la bande dessinée est injustement méprisée. Je verrais plus loin si ces deux objectifs ont pu être remplis.
Quelques remarques sur ces deux évolutions : il faut, comme toujours, les replacer dans leur contexte. Les années 1960 voit l’émergence d’une bédéphilie extrêmement militante dont l’objectif est à la fois de discuter entre soi de son amour pour la bande dessinée, et de le faire partager au reste de la société. La Socerlid est issue d’une branche de la bédéphilie qui s’est organisée en des structures associatives et des revues (et qui possède donc les moyens de monter une exposition et rédiger un catalogue). Elle privilégie une lecture nostalgique du medium, essentiellement tournée vers la bande dessinée américaine des années 1930 (de ce qu’ils appellent « l’âge d’or » et qu’ils situent entre 1934, naissance du Journal de Mickey en France, et 1942, interdiction de l’importation de bandes américaines). Même au niveau de la création contemporaine, les membres de la Socerlid s’intéressent essentiellement à la bande dessinée pour enfants : André Franquin plutôt que Jean-Claude Forest, Tintin plutôt que Hara-Kiri. L’exposition est à l’image de l’association, privilégiant le domaine américain (Thierry Groensteen a abondamment développé au sujet des erreurs d’appréciation de la bédéphilie nostalgique, je vous renvoie donc à la bibliographie en bas de l’article).
Autre chose : l’exposition de 1967 vient en réalité comme le climax d’une série d’expositions plus confidentielles organisées par les associations bédéphiliques comme un point fort de la lutte entre CELEG et Socerlid. En effet, là où le CELEG privilégie une approche assez simple de regroupement entre amateurs éclairés, la Socerlid s’en distingue par sa volonté « propagandiste » active, et l’exposition en est un des nouveaux moyens (à côté des réunions, des publications critiques et des rééditions, modes d’expression déjà introduits par le CELEG dans le champ de la bédéphilie), amplement plus visible et médiatique. Trois expositions seront organisées par la Socerlid : « 10 millions d’images, l’âge d’or » de la BD en 1965, « Burne Hogarth » et « Milton Caniff » en 1966. Les notions d’expositions et de scénographie n’était donc pas totalement inconnues des organisateurs ; Pierre Couperie, historien de formation, sera un des principaux metteurs en oeuvre de ces expositions. La Socerlid n’est pas la seule association à organiser des expositions de ce type : le Club des Amis de la Bande dessinée (branche belge du CELEG, devenue autonome), organise plusieurs expositions, dont une « Introduction à la bande dessinée belge » à la Bibliothèque Albert Ier de Bruxelles. D’autres expositions suivront : en 1974, lors du premier salon d’Angoulême, Pierre Couperie présente Le noir et blanc dans la bande dessinée.
Premier objectif : la médiatisation de la bande dessinée et de la bédéphilie nostalgique
Le résultat le plus évident et le moins contestable est que l’exposition « Bande dessinée et Figuration narrative » a donné une tribune médiatique nouvelle à la bande dessinée. Durant la seconde moitié des années 1960 se produit un mouvement qui fait passer la bande dessinée d’objet peu considéré à phénomène médiatique. L’occasion pour moi de rappeler que ce qu’on appelle généralement « passage à l’âge adulte » de la bande dessinée française (et que l’on situe, vaguement, dans cette décennie) est moins l’arrivée d’une bande dessinée adulte (qui existait déjà avant, et en grande quantité, dans la presse quotidienne) que l’arrivée sur le marché de revues entièrement composées de bandes dessinées (imitant en cela le modèle des revues pour enfants), à destination des adultes (Chouchou, Fluide Glacial, L’Echo des savanes, Métal Hurlant). Autrement dit, un transfert de modèle éditorial, qui s’accompagne naturellement d’une augmentation conséquente du nombre de dessinateurs travaillant pour le public adulte et du début de la fin du préjugé qui, dans l’inconscient collectif, accuse la bande dessinée du « péché d’infantilisme » (pour reprendre une expression de Thierry Groensteen).
L’exposition de 1967 est évidemment indissociable de ce mouvement ; il faut se souvenir qu’un autre événement sert souvent de jalon à la faveur nouvelle dont bénéficie la bande dessinée : la couverture de L’Express sur Astérix en septembre 1966 (même si on y parle davantage du phénomène économique que des qualités graphiques et narratives de la série). De nombreux articles accompagnent l’exposition, et dans une frange très large de la presse, du Figaro littéraire au Canard enchaîné. Toutefois, comme le souligne Groensteen, il faut y apporter une nuance : « A se pencher sur la revue de presse, on constate d’ailleurs que, si le nombre d’articles fut très élevé et dépassa sans doute les espérances des organisateurs (…) la tonalité des articles ne fut pas toujours des plus favorables. » (T. Groensteen, Un objet culturel non identifié, p.160). Plusieurs journalistes ne s’intéressent qu’à la partie « Figuration narrative », par exemple. Le seul critère médiatique, s’il est un indice, ne suffit pas à disqualifier l’ensemble : le retentissement de l’exposition face au grand public semble avoir été important.
La rhétorique du passage à l’âge adulte, fréquemment employée, s’accompagne aussi de celle du passage « art mineur »/ « art majeur ». Il m’intéresse précisément quand je parle d’expositions dans la mesure où la notion « d’exposition » est liée à celle de contemplation artistique, par opposition au livre de bande dessinée qui se feuillette. Les Beaux-Arts servent alors d’étalon et de modèle pour l’exposition de bande dessinée (ce d’autant plus qu’on en conclut, un peu vite, qu’on a affaire à de l’image dans les deux cas), et, dans la logique qui est celle des organisateurs de la Socerlid, exposer annoblit. Or, sur ce point précis, l’exposition « Bande dessinée et Figuration narrative » est extrêmement ambitieuse, puisqu’elle ne propose pas seulement d’exposer de la bande dessinée, elle veut aussi la comparer à des peintures.
Second objectif : la bande dessinée devient un « art majeur »

Bernard Rancillac, Où es-tu ? Que fais-tu ?, 1965 : un exemple d'utilisation de personnages de bande dessinée par les peintres de la Figuration Narrative
Reprenons : les plus savants d’entre vous auront repéré ce qu’est la Figuration narrative, et quel peut être le lien avec la bande dessinée. La Figuration narrative est un mouvement artistique, essentiellement pictural mais qui s’étendit aussi à la sculpture. Il marque, au début des années 1960, un retour au figuratif après une longue période dominée par l’abstraction et partage de nombreuses caractéristiques avec des courants contemporains comme le Pop art américain, ou avec le Nouveau réalisme français, tout en essayant aussi de se démarquer de ces deux grands aînés. La Figuration narrative ne s’affirme jamais à proprement parler comme un mouvement construit ; elle regroupe des artistes comme Bernard Rancillac, Hervé Télémaque, Eduardo Arroyo, Jacques Monory. C’est le critique d’art Gérard Gassiot-Talabot qui définit le terme et lui donne son contenu théorique. C’est aussi lui qui s’occupe de la partie « Figuration narrative » de l’exposition de 1967. La vision idéalisée de « Bande dessinée et Figuration narrative » est celle de la rencontre entre deux militantismes culturels du milieu des années 1960 : la bande dessinée en pleine « légitimation », et la Figuration narrative est en plein épanouissement après deux expositions marquantes en 1964 (« Mythologies quotidiennes » au Musée d’art moderne de la Ville de Paris) et en 1965 (« La figuration narrative dans l’art contemporain », 1965), dont Gassiot-Talabot est le metteur en oeuvre.
Voici pour la partie « Figuration narrative ». Il faut noter que, dans la catalogue de l’exposition, sur 12 chapitres, un seul traite du mouvement artistique (rédigé par Gassiot-Talabot) et ce n’est qu’au sein de ce chapitre que l’on peut lire une analyse intéressante sur les rapports entre bande dessinée et peinture qui s’attache surtout à en pointer les différences et à souligner l’ambiguité des relations qui peuvent s’établir entre les deux. Pourtant, l’objectif des membres de la Socerlid était bien d’ériger la bande dessinée en « art » par une comparaison avec la peinture contemporaine et par la présence au sein d’un musée, dans le sillage de Claude Beylie qui est le premier à avoir proposé l’appellation de « neuvième art » dans une série d’articles pour le journal Lettres et médecins en 1964. Le sous-entendu théorique de cette tentative de rapprochement entre bande dessinée et art « majeur », qui sous-tend tout le catalogue (à l’exemple d’une préface de Burne Hogarth), est que l’annoblissement du medium ne peut passer que par une élévation comme un des Beaux-Arts (idée que je jure pour ma part assez vaine et inutile). D’où la volonté de « mimer » les gestes de l’art, notamment par une exposition au musée (le lieu prend ici tout son sens : rappelons que le musée des arts décoratifs se situe dans les locaux du musée du Louvre).
Si le premier principe de l’annoblissement de la bande dessinée est la juxtaposition avec un mouvement artistique, le second est le choix d’une scénographie spécifique. Je vous renvoie là encore à mes références bibliographiques et webographiques pour plus de détails, mais je m’arrête sur quelques points. La scénographie de « Bande dessinée et Figuration narrative » (en ce qui concerne la partie bande dessinée) est réalisée par Isabelle Coutrot-Chavarot. Son objectif principal (je reprends là une analyse de Pierre-Laurent Daures) est de rompre les habitudes de lecture du public en leur montrant des cases de bande dessinée autrement, en l’occurence sous la forme d’agrandissements photographiques noir et blanc de cases jugées « remarquables ». Cette décision est à la fois liée à des contraintes matérielles (le manque de planches originales) et à une visée théorique (montrer de près la qualité du dessin et la spécificité du trait). L’agrandissement est paradoxalement vécu comme une renaturation de la case, qui serait mutilée par l’impression et la colorisation (un même argument pourra servir, plus tard, à mettre en avant la qualité de la planche originale comme objet d’exposition). Il monumentalise la case de bande dessinée. Enfin, il est aussi un autre moyen de comparer les oeuvres picturales et les oeuvres graphiques, en les mettant à la même échelle.
Je ne serais pas le premier à dire que cet objectif de mise à niveau de la bande dessinée sur la peinture a plutôt été un échec. Il est possible que nous soyons face à un malentendu. C’est ce que peut suggérer une lecture espiègle des premières phrases du chapitre rédigé par Gassiot-Talabot, qui donne l’impression de se dédire de tout lien avec la Socerlid, lui qui s’intéresse au mouvement de la Figuration narrative : « La présence de quelques tableaux dans l’exposition organisée par le Musée des Arts Décoratifs, ce chapitre même, qui termine un ouvrage consacré pour sa plus grande partie à l’histoire, à l’esthétique et à la sociologie de la bande dessinée, pourraient produire quelque confusion et prêter aux auteurs de ce livre des intentions qu’ils n’ont pas. Pour situer les raisons de cette entreprise, et les limites de ma collaboration avec les membres de la Socerlid, il faut rappeler que le problème de la Figuration narrative a fait l’objet de travaux antérieurs qui rendent inutiles un nouvel exposé théorique et une étude analytique des catégories narratives. » (p.229 du catalogue). La juxtaposition entre bande dessinée et figuration narrative apparaît encore davantage comme un mariage forcé lorsqu’on sait qu’en réalité, la partie picturale a été imposée par le conservateur du musée, François Mathey. Pour reprendre les termes de Groensteen : « Les deux parties de l’exposition constituaient deux projets distincts, arbitrairement réunis pour la circonstance. » (p.159, Un objet culturel non identifié). La transformation de la bande dessinée en art majeur est donc en grande partie rendue impure dans la mesure où une condition est mise à son entrée dans un musée, et où il y a juxtaposition plus que dialogue entre les deux parties.
Impureté de la bande dessinée considérée comme un des Beaux-Arts
Pour terminer sur un point de vue un peu plus réflexif, j’aimerais souligner le fait que mettre sur un pied d’égalité la bande dessinée américaine réaliste ou l’Ecole de Bruxelles d’un côté et la Figuration narrative de l’autre, comme le firent, un peu malgré eux, les membres de la Socerlid n’est pas sans amener un triple contresens (les deux premières remarques viennent en grande partie des réflexions de Gassiot-Talabot lui-même dans le catalogue, la troisième m’a été inspirée par les écrits plus récents de Christian Rosset).
1.La première observation est que l’usage de la narration par la Figuration narrative diffère de celle de la bande dessinée. En bande dessinée, la narration est en quelque sorte inévitable et intuitive : elle n’est jamais soulignée, sauf pour créer un effet comique de mise en abyme. Dans la Figuration narrative, la narration est au contraire savamment analysée et le public doit en être conscient pour comprendre la démarche artistique propre à ce mouvement, démarche qui se propose expressément d’interroger le statut de « l’image narrative » dans un art comme la peinture basé sur l’unité du tableau. Thierry Groensteen regrette d’ailleurs que le nom de l’exposition ait entraîné une confusion chez le public qui a pu croire que « Figuration narrative » était une périphrase pour désigner la bande dessinée, erreur qui reste encore courante.
2.L’utilisation de la bande dessinée par la Figuration narrative, comme par le Pop Art ou le Nouveau Réalisme, pose problème car un artiste comme Roy Lichtenstein (mais aussi Rancillac, Erro et Fahlström) utilise la bande dessinée « ainsi qu’un matériau sociologique utilisable au même titre que la réclame publicitaire, le roman photo, le schéma technique, la planche de magazine, l’article de journal, la reproduction d’art, ou tout simplement l’objet préfabriqué qui sert de jalon dans le développement du parcours intérieur. » (Gassiot-Talabot, p.235 du catalogue). L’image de la bande dessinée transmise par les artistes narratifs est donc exactement inverse à celle que défend la Socerlid.
3.Enfin, j’avais souligné que l’exposition était la rencontre de deux militantismes. Or, ils oeuvrent dans des directions diamétralement différentes. La Figuration narrative est un mouvement de contestation face à la peinture établie (aussi bien l’art abstrait que le Pop Art américain) qui se veut contestataire et moderne. La Socerlid, elle, en tant que bédéphilie nostalgique, est tournée vers le passé et nettement moins vers la créations contemporaine, en particulier lorsqu’elle bouleverse les règles classiques qui régissent le medium depuis des décennies. Elle veut au contraire devenir un art établi. Ainsi, Jean-Claude Forest, dont l’esthétique est pourtant plus proche du Pop Art et de sa subversion que celle d’Hergé, est déprécié dans le catalogue. Certains auteurs choisis par la Socerlid pour être exposés (Milton Caniff, Burne Hogarth, Hergé) sont éminemment académiques et leur noir et blanc, ici présenté, semble jurer avec les couleurs vives de la Figuration narrative, de même que leur réalisme et leur exactitude jurent avec la déformation corporelle ou la recherche du détail absurde que l’on peut trouver dans le mouvement pictural.
Au final, le nouveau paradigme de la « BD au musée » qu’a voulu introduire l’exposition « Bande dessinée et Figuration narrative » n’est atteint qu’en partie, et de façon impure.
Ajout au 13 juillet 2011 : suite au commentaire de Maurice Horn, qui a participé à l’exposition et notamment à la traduction du catalogue aux Etats-Unis, il convient de préciser qu’au-delà de l’impact médiatique national, qui est le sujet de cet article, l’exposition a été connue par son catalogue (traduit en anglais sous le titre A History of Comic Strip par Maurice Horn) au niveau international.
Pour en savoir plus :
Un catalogue de l’exposition a été édité par le SERG. Il est malheureusement épuisé, mais on peut à l’occasion le trouver dans quelques bibliothèques avant-gardistes qui s’intéressaient déjà à la BD dans les années 1960 !
Thierry Groensteen consacre plusieurs pages au sujet de l’exposition « Bande dessinée et Figuration narrative » dans son La bande dessinée, un objet culturel non identifié, Editions de l’an 2, 2006 (p.155-160 ; plusieurs réflexions sur le mouvement bédéphilique sont tirées du même ouvrage.)
Enfin, un mémoire existe sur le sujet, soutenu et réalisé par Antoine Sausverd en 1999 à l’Université de Bourgogne (Dijon).
Site de la scénographe, avec quelques photographies de l’exposition : http://www.isastyle.com/bd.htm
Et enfin, une synthèse sur la Figuration narrative par le Centre Pompidou, avec des commentaires d’oeuvres.