Le (relativement) long silence de ce blog était lié à ma présence à plusieurs colloques universitaires, dont celui de l’Université de Liège, organisé par le groupe ACME du 16 au 18 juin, Poétiques de l’algorithme. Je remercie les organisateurs d’avoir préparé ce moment passionnant qui nous aura permis de mettre en lumière l’impact des nouvelles technologies sur les arts. J’ai été ravi d’animer une table ronde en présence de quatre créateurs palpitants dont j’invite mes lecteurs à aller voir/lire la production :
- Anthony Rageul, dit Tony, auteur-théoricien de « récits-interfaces » : http://www.anthonyrageul.net/
- Nicolas Labarre, chercheur et auteur, venu présenter son travail d’article scientifique en bande dessinée : http://picturing.hypotheses.org/
- Daniel Merlin Goodbrey, pionnier britannique de la création graphique numérique : http://e-merl.com/
- Yannis La Macchia, auteur éditeur genevois (Une fanzine carré) qui se lance depuis peu dans l’expérimentation numérique : http://yannislamacchia.com/
De mon côté, je présentais une communication intitulée « Les paradoxes de l’innovation numérique dans la bande dessinée française » dont je vous livre le texte ci-dessous… Bonne lecture !
Introduction :
Comme de nombreux autres arts au XXIe siècle, la bande dessinée est confronté aux évolutions récentes des technologies informatiques, que ce soit en termes de création ou de diffusion. Cette intervention porte spécifiquement sur le nouvel objet médiatique qu’est la « bande dessinée numérique », au sens d’oeuvres créées pour être nativement publiées au format numérique, et faisant formellement référence à un média, la bande dessinée. La question à laquelle je vais tenter de répondre est la même que les autres intervenants de ce colloque : « Quel est impact d’un changement de paradigme technologique sur une forme artistique, la bande dessinée ? »
Toutefois, le regard que je vais porter sur la bande dessinée numérique est celui d’un historien, ce qui implique deux types d’approches spécifiques :
- l’historien s’intéresse à son objet sur le temps long, et s’appuie pour cela sur des méthodes comparatives pour mettre en évidence des évolutions dans le temps, sur de grands nombres d’oeuvres. L’approche historienne complète ici les approches habituelles portées sur la bande dessinée numérique, portant sur des œuvres ponctuelles, étudiées de façon diachronique, pour leur caractère exceptionnel.
- L’historien de la bande dessinée éprouve une certaine méfiance à l’égard de la notion de « progrès » dans les arts. L’historiographie récente de la bande dessinée, d’après les travaux de Thierry Smolderen, Harry Morgan ou Eric Maigret, est assez largement revenue de l’idée que l’évolution de l’art de la bande dessinée est une progression, une suite d’améliorations, vers une forme idéale. Il me semble que la même méfiance doit s’appliquer à l’étude de la bande dessinée numérique : ses évolutions ne tendent pas nécessairement vers ce qui serait l’idéal d’un croisement entre bande dessinée et numérique. Il est plus intéressant d’étudier les différentes voie prises par les auteurs dans un contexte où la standardisation demeure faible.
En somme, le regard de l’historien interroge la notion « d’innovation formelle », pour une reformulation « sceptique » de la question initiale : il ne s’agit pas tant de savoir « quel est l’impact » des technologies sur les arts, mais de commencer par se demander si cet impact est réel, et entraîne nécessairement l’apparition de formes nouvelles. L’objectif final est bien de comprendre l’évolution technologique des arts, dans tous ses aléas et ses hésitations.
1. La mise en évidence d’un paradoxe
Dans le cas de la bande dessinée numérique, il est assez aisé de mettre en évidence un véritable paradoxe en comparant deux œuvres de deux décennies différentes :
- d’un côté, John Lecrocheur de Simon Guibert et Julien Malland, une œuvre de 1998-1999 produit par I/O Interactifs et Wanadoo éditions
- de l’autre côté le webcomic Sans emploi de Jibé, diffusé sur son blog entre 2004 et 2012
Une comparaison formelle des deux œuvres permet de mettre en évidence, à un premier niveau d’analyse, des différences déjà singulières :
| Forme narrative | planche « déconstruite » (les cases se superposent au fur et à mesure) | Format du strip (bande horizontale) : succession de cases pour un gag court |
| Animation de l’image | effets d’animation présents (ex : arrivée d’un hydravion dans l’image) | pas d’effet d’animation : images fixes |
| Effets complémentaires | possibilité de « zoom » ponctuels
sons : musique et bruitages |
pas d’effets complémentaires |
| Interactivité | le lecteur doit « trouver » où cliquer (dans la diégèse) ; son clic peut déclencher des actions (cigarette allumée, etc…) | possibilité de commenter (hors diégèse) |
Ainsi peut s’énoncer le paradoxe : l’oeuvre la plus ancienne est aussi celle qui contient le plus d’innovations formelles par rapport à la forme initiale de la bande dessinée. Elle est celle qui prend le plus en compte, dans sa forme, les potentialités du support numérique de diffusion qui est le sien, là où l’oeuvre la plus récente s’avère être la plus proche d’une bande dessinée imprimée, dans son refus de l’image animée et des effets numériques.
La représentativité des deux œuvres choisies pour cette comparaison est réelle : elles sont représentatives de la production dominante de leurs époques respectives :
- la fin des années 1990 voit apparaître plusieurs œuvres dites « bandes dessinées interactives » ou « multimédia » qui, comme John Lecrocheur, comprennent des animations, du son, et invitent le lecteur à une forme d’interactivité
- la seconde moitié des années 2000 est marquée par la vague des « blogs bd », à l’image de Sans emploi, qui s’appuient formellement sur des formats traditionnels de planche ou de strips sans ajout d’effets purement numériques
Attention : il n’y a pas de jugement de valeur dans cette comparaison : John Lecrocheur n’est pas une « meilleure » œuvre numérique que Sans emploi parce qu’elle prend davantage en compte les possibilités de son support, ou parce qu’elle cherche à s’éloigner davantage de la bande dessinée papier. En revanche, la comparaison permet de faire apparaître trois constats au regard de la question du progrès technologique appliqué à la bande dessinée :
- la progression technologique n’apparaît pas comme nécessaire : l’évolution formelle des œuvres ne va pas nécessairement dans le sens d’une meilleure prise en compte du changement technologique
- le changement de paradigme technologique ne se lit pas en termes de rupture : des innovations survenues à une époque antérieure ne suppose pas l’abandon de formes « analogiques »
- les innovations formelles potentielles sont présentes dès le départ : elles n’apparaissent pas les unes après les autres dans le temps, mais sont connues dès le départ par plusieurs auteurs (Benoît Peeters, Scott McCloud)
Cette observation vaut aussi quand on observe :
– la carrière d’un auteur comme Fred Boot, qui passe d’oeuvres à la frontière entre la bande dessinée et les arts numériques (les adaptations numériques des albums de Boilet autour de 2002-2004) à des prépublications au format planche autour de 2008 (Balsamo, sur Webcomics.fr)
– l’ambition des projets d’auteurs professionnels, par la comparaison deux plateformes d’auto-édition : @Fluidz entre 1999 et 2005 explore des formats loin de la bande dessinée (jeu vidéo, animation, vidéo…) alors que sur la plateforme 8comix, entre 2011 et 2014, sur les 9 récits publiés, 6 utilisent un format planche, 1 utilise le format strip, et seulement 2 optent pour des formats qui rompent avec les codes matériels de la bande dessinée.
De fait, dans le cas français, les toutes premières bandes dessinées numériques, de la période 1995-2005, s’avèrent plus « innovantes » formellement que celles de la décennie suivante.
2 : Causes et analyse du paradoxe
Quelles explications peut-on donner à ce phénomène paradoxal ?
- des explications économiques : l’éclatement de la bulle spéculative autour de l’économie de l’Internet au début des années 2000 a ralenti le financement d’oeuvres ambitieuses technologiquement parlant, comme John Lecrocheur financé par Wanadoo et produit par une petite entreprise, I/O Interactifs, qui ne passera pas le cap de l’an 2000. En l’absence de structures de financement, les productions des années 2000 sont, pour la plupart, du registre de l’auto-édition, à la façon de Sans emploi, et relativement simple technologiquement.
- des explications sociales : la démocratisation du réseau Internet (pour la France : 14% d’abonnés en 2000, 58% en 2008) entraîne l’arrivée d’un public moins technophile que le premier public du Web, et dont les attentes en terme d’innovations technologiques sont moindres. Des œuvres comme John Lecrocheur avaient aussi valeur de « démonstration » auprès d’un premier public des supports numériques exigeant.
Vont davantage m’intéresser les explications esthétiques : il y a dans les années 2000 une véritable vigueur du modèle de la bande dessinée imprimée, comme forme et comme matérialité. Il faut rappeler ici que, contrairement aux Etats-Unis, le marché français de la bande dessinée imprimée se porte bien durant les années 2000 : il apparaît comme dynamique, en pleine croissance, et parvenu à une forme de diversité entre grosses structures et petite maison. Les années 2000, avec la généralisation du terme « roman graphique », voir le triomphe du format « album », au détriment de la revue, avec un intérêt particulier porté à l’objet-livre, par exemple chez les alternatifs. Ainsi, le format livre a une aura incontestable pour les auteurs et les lecteurs.
Comment se traduit cette vigueur de l’imprimée pour la bande dessinée numérique ? S’intéresser aux permanences de la matérialité dans les créations graphiques numériques, c’est s’intéresser à l’envers de l’innovation. C’est essayer de savoir jusqu’à quel point les auteurs numériques des années 2000 ont influencé par les standards de l’imprimé. Ici l’analyse de masse d’oeuvres vient compléter l’analyse ponctuelle par des éléments statistiques permettant de répondre à la question : « combien d’oeuvres numériques font appel à des formats de dessin issu de l’imprimé ? ».
Par exemple, si on observe les 89 œuvres publiées sur la plateforme Webcomics.fr durant l’année 2007 (année de son apparition) et qu’on les répartit simplement en fonction de leur format en trois catégories (format « planche », format « strip », autre format sans référence dans l’univers imprimé), on obtient la répartition suivante :
- 65% utilisent le format « planche »
- 18% utilisent le format strip.
- Seul 17% des œuvres sortent de ces deux formats
Plus encore, seules deux œuvres utilisent véritablement des effets que l’on pourrait considérer comme spécifiquement numériques : combinaison d’animations, de sons, de liens hypertextes dans l’image, d’interactivité…
Mieux encore, dans certains cas, les auteurs cherchent à conserver des caractéristiques « paratextuelles » venu du monde du livre imprimé comme la couverture, le chapitrage ou la table des matières. Il faut considérér ici le fait que, durant cette période, l’horizon d’attente pour beaucoup de créateurs numériques est la publication papier de leur œuvre. Elle doit ainsi être, dès le départ, « formaté » à cette fin.
Dans l’exemple de Webcomics.fr, et alors même que l’outil de publication ne l’interdit pas, il est manifeste que les auteurs ne recherchent pas l’innovation technologique au sens de « nouvelles formes liées à la technologie ». Un même constat s’opère pour la plupart des plateformes de diffusion des années 2000 : Grandpapier.org, le portail Lapin, Manolosanctis, ainsi que pour la plupart des « blogs bd ».
Il me faut préciser un peu cette observation : les formats « planche » et « strip » sont certes majoritairement repris et demeurent l’horizon de référence, mais ils sont aussi souvent déformés. Plus que d’une imitation de la matérialité livresque dans un contexte numérique, il faut parler d’adaptation de cette matérialité. Deux exemples le montrent de façon assez éloquente :
-

Rodho, Les aventures du professeur Quignard, 2007 : un exemple de format « carré » ou « demi-planche »
sur Webcomics.fr, un format apparaît et tend à s’imposer au fil des années, c’est le format « carré » ou « demi-planche » qui consiste à réduire la taille d’une planche, d’ordinaire plus large que haut, à l’espace d’un seul écran pour éviter d’avoir à dérouler la page Web
- à l’inverse, sur les blogs bd, on assiste au triomphe du « scrolling vertical » : la planche est allongée jusqu’à être transformée en un immense rouleau de lecture que l’on déroule. Si on retrouve souvent derrière la trace de l’organisation spatiale d’une planche ou d’un strip, il y a déformation de ces deux formats imprimés pour les adapter à un usage propre au numérique, le défilement vertical.
Néanmoins, la référence demeure l’image fixe de l’imprimé : peu ou très peu d’oeuvres « spécifiquement » numériques durant cette période.
Benoit Berthou dresse ce constat en commentant les bandes dessinées numérisées : « la plus-value du numérique n’a alors rien d’évident. (…). Force est de constater que subsiste à l’heure des nouvelles technologies l’hégémonie d’un certain mode d’organisation livresque de l’information. » (Bande dessinée et numérique, sous la direction de Pascal Robert, CNRS Editions, 2016, p.200-201). Ce constat vaut aussi pour la création originale de l’époque. De fait, et si on met de côté quelques rares expérimentations, l’esthétique dominante de la bande dessinée numérique de la période 2005-2009 est l’esthétique de la « planche scannée ». Sur le plan des formes, l’imprimé tient bon face au numérique puisqu’il lui sert, dans un premier temps d’esthétique de référence.
3. Penser le paradoxe
Comment penser en historien ce paradoxe d’une évolution technologique semblant aller « à rebours » ?
Tout d’abord, le recours aux conclusions de l’histoire des techniques est essentiel, pour se rendre compte que cette observation dressée dans le cadre de la bande dessinée répond à une tendance forte de l’histoire des techniques. Elle nous renvoie à « l’effet diligence » de Jacques Perriault : « Une invention technique met un certain temps à s’acclimater pour devenir une innovation, au sens de Bertrand Gille, c’est-à-dire à être socialement acceptée. Pendant cette période d’acclimatation, des protocoles anciens sont appliqués aux techniques nouvelles. Les premiers wagons avaient la forme des diligences. » (L’accès au savoir en ligne, Odile Jacob, 2002, p.52-53).
En effet, l’histoire des techniques n’est pas qu’une histoire du progrès technologiques : c’est, surtout et avant tout, une histoire sociale qui passe par la connaissance des usages plutôt que par un primat de l’invention (Bertrand Gille).
Dans le cas de la bande dessinée, peut-on mesurer les usages ? C’est ce qu’il faudrait réaliser, en élargissant l’étude statistique menée sur Webcomics.fr. Je propose ci-dessous une forme de schématisation de l’innovation dans la bande dessinée numérique. En l’état, il est le résultat d’observations empiriques et encore non-chiffrés, il exprime une tendance observée qui pourrait être précisé à l’avenir par des statistiques. Il s’agit de mesurer, pour chaque période de cinq ans, la part de bande dessinée numérique de création « innovante », proposant un usage de la technologie propre à modifier la forme, et la part de création dont l’horizon de référence est la bande dessinée imprimée.

Une tentative de schématiser les tendances à l’innovation formelle dans la band dessinée numérique, sur le temps long. Le jaune représente la part des oeuvres « innovantes » produites durant le lustre considéré.
Le schéma se lit comme suit : l’oeuf représente l’ensemble de la production d’oeuvres numériques pour la période considérée. La bulle jaune au centre marque la part des œuvres « innovantes » sur le plan de la forme.
Il cherche à exprimer deux tendances importantes :
- il y a probablement une relation entre l’augmentation du nombre d’oeuvres et la diminution de la part des œuvres formellement innovantes : la généralisation de la pratique de création numérique passe par un rapport fort à une matérialité antérieure
- depuis 2010, on assiste à un renouveau de la création d’oeuvres spécifiquement pensées pour une lecture numérique. Cela se traduit par :
- le diaporama dynamique comme nouveau paradigme formel
- l’hybridation de plus en plus marqués entre image fixe et image animée
- l’appropriation de nouveaux modèles par des auteurs professionnels
- l’adaptation des formats à une diversification des écrans (smartphone, tablettes…)
Avec ces observations, l’analyse de Jacques Perriault prend tout son sens dans le cas de la bande dessinée numérique : les années 2000 apparaissent comme une nécessaire phase de transition durant laquelle les auteurs numériques restent attachés aux formats imprimés, que ce soit pour des raisons symboliques ou économiques, avant le développement d’oeuvres spécifiques à la lecture sur support numérique.
C’est là une manière de penser le paradoxe du numérique pour la bande dessinée. On tendrait alors vers une meilleure prise en compte des spécificités numériques dans la création. Mais pour ma part, je préfère me garder d’une conclusion aussi définitive et conserver un regard sceptique d’historien face à ce qui est une vision encore trop téléologique, Et cela pour plusieurs raisons :
- Contrairement à l’exemple des trains et des diligences, la bande dessinée numérique ne « remplace » pas la bande dessinée papier. Elle ne répond pas à un même usage mais en déplace l’usage sur un autre support
- Il est ici question d’art et d’esthétique, et l’évolution des arts n’est pas linéaire, une forme n’en remplace pas une autre.
- J’ai considéré ici uniquement l’innovation formelle, mais d’autres formes d’innovation se développent avec les nouvelles technologies et peuvent se trouver dans des oeuvres peu innovantes formellement, comme par exemple les nouvelles formes de rapport au public dans les blogs bd comme innovation « communicationnelle » qui n’a pas d’impact sur la forme, mais marque un changement considérable
- Même si ces dernières années voient un retour de l’expérimentation numérique, un grand nombre des créations s’inscrivent encore dans la permanence de l’imprimé. Il est encore tôt pour dire si nous sommes face à une tendance réelle, ou à un épiphénomène.
Après tout, rien n’empêche de voir se maintenir, dans la création numérique, les deux tendances, celles de la spécificité numérique et celle de la référence à l’imprimé. A l’heure actuelle, c’est plutôt cette cohabitation qui se dessine.
En conclusion : j’espère avoir montré en quoi un regard et des méthodes d’historien permet d’éviter une forme de naïveté face à la technologie et son influence sur les arts. L’idéal progressiste et technophile n’est pas à rejeter, mais il ne doit pas être considéré comme la seule fin en soi : la bande dessinée numérique n’est pas « condamnée » à se détacher de son aînée papier, son histoire n’obéit pas forcément à un affranchissement des logiques de l’imprimé.
Le numérique n’est pas forcément une « révolution », ne doit pas se penser en termes de rupture. Les observateurs de la création numérique se focalisent souvent sur les différences, alors même que les permanences sont tout aussi passionnantes et instructives et, surtout, ne présage en rien de la qualité des œuvres. La période que nous vivons actuellement est justement passionnante parce qu’elle est celle d’une forme d’équilibre entre deux idéaux, le vieux monde de l’imprimé et les promesses de la création numérique.


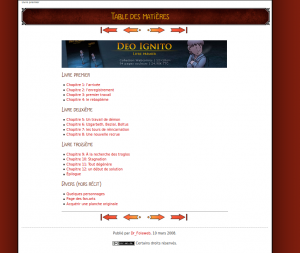
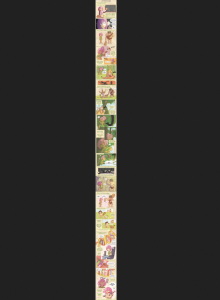
http://andrebergs.com/protanopia/ apporte peut être une pierre au récit.